« Ce qui m’intéresse, c’est ce qui fait défaut dans l’œuvre »
Si le grain ne meurt…
____________________________
Biographie
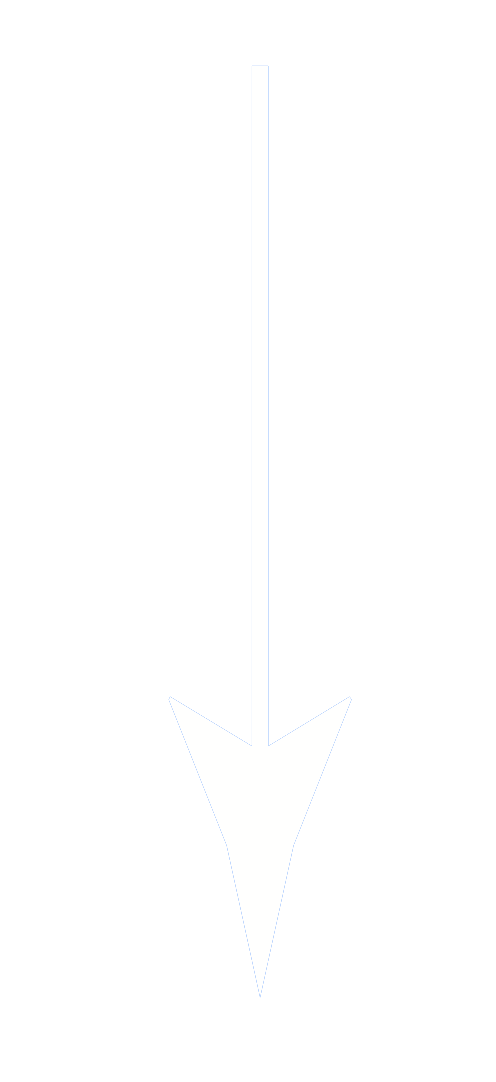
Je suis né dans les Hauts-de-Seine à Châtillon, et l’ironie du sort veut que j’habite aujourd’hui Montrouge. Pour autant, j’ai grandi à Clermont-Ferrand dans une famille dont le père, centralien, s’est retrouvé ingénieur chez Michelin et la mère, comédienne amateur. Très vite, je me suis retrouvé sur scène dans les pièces que mon père écrivait pour la compagnie de théâtre Le Valet de Cœur qu’il avait créée avec ma mère en 1977 et qui est aujourd’hui une véritable institution clermontoise située dans le quartier du Port. Aussi loin que je me souvienne, j’ai toujours voulu être comédien et mes souvenirs les plus vifs sont rattachés pour la plupart à la lumière de projecteurs réchauffant les planches de scènes de théâtres à l’italienne.
Au moment de mon adolescence,
la lecture des Lettres du voyant de Rimbaud a bouleversé ma vie : “j’assiste à l’éclosion de ma pensée : je la regarde, je l’écoute : je lance un coup d’archet : la symphonie fait son remuement dans les profondeurs, ou vient d’un bond sur la scène.” Je suis rentré à 16 ans au conservatoire d’art dramatique à Clermont-Ferrand dans la classe de diction car à l’époque une classe de diction préparait à l’art dramatique. Une des premières choses que mon professeur Josépha Jeunet m’a confié au conservatoire a été la préparation du parcours scénique d’un chanteur, le personnage de Zurga dans Les Pêcheurs de perle de Georges Bizet. Cette découverte de l’opéra m’a procuré un plaisir inouï. Moi qui venais d’une famille de théâtre qui n’était ni musicienne ni particulièrement mélomane, j’avais l’impression d’avoir découvert un espace qui pouvait m’appartenir.

J’ai ensuite suivi des études de lettres à l’Université Blaise Pascal tout en poursuivant de jouer dans des compagnies professionnelles régionales comme comédien et notamment à la scène nationale à la Comédie de Clermont-Ferrand sous la direction de Jean-Pierre Jourdain.
Mes études de lettres
ont été très formatrices et j’ai été extrêmement influencé par des professeurs comme Michel Lioure, Robert Pickering ou Jacques-Philippe Saint-Gérand. Grâce à eux, j’ai appris une méthodologie autrement précieuse pour la mise en scène à la faveur de l’exercice du commentaire composé ou de la dissertation. Et chaque fois que je prépare une mise en scène, je me sens un peu à mi-chemin entre l’universitaire et l’écrivain, ou plutôt je me sens à la fois l’un puis l’autre.
Suite à mon travail de mémoire de maîtrise au sujet de Samuel Beckett en 1995, il a fallu que je fasse mon service militaire. Opposé à l’usage des armes, objecteur de conscience, je me suis retrouvé à travailler comme administrateur dans une compagnie de théâtre dirigée par André Dunand à Gentilly ; une compagnie qui avait eu ses heures de gloire avec L’extraordinaire Épopée de Ferdinand Bardamu, un spectacle conçu autour des œuvres de Louis-Ferdinand Céline. Le spectacle avait rencontré un vrai succès et avait tourné un peu partout en France. Pourtant, la compagnie, sans véritable projet, était en perte de vitesse. Je me retrouvais donc à devoir faire des relances, du mailing comme on dit aujourd’hui, et j’ai découvert de façon très pratique le travail administratif à travers les déclarations URSSAF, les taux des cotisations patronales et salariales que je connaissais par cœur à l’époque, et les feuilles de salaire dont je faisais moi-même les tableaux Excel. Ceci étant dit, je me suis surtout beaucoup ennuyé et j’ai dû me trouver des occupations pour passer le temps. J’ai lu énormément et en particulier toute l’œuvre de Dostoïevski dont j’ai tiré un spectacle en solo avec
La Confession de Stavroguine,
un fragment longtemps censuré des Démons, dans lequel le personnage se découvre moins nihiliste qu’on ne le pense, à travers la reconnaissance du viol d’une fillette qui s’est suicidée : “C’est ce tableau que je vis en rêve, non comme un tableau pourtant, mais comme une réalité”.

Paysage côtier avec Acis et Galatée, 1657, Claude Gelée dit Lorrain
J’ai également beaucoup écrit : des poèmes, des chansons, des scénarii, des essais. C’est de cette époque que datent mes Leçons de Ténèbres (Comp’Act, 2006) et les textes d’Une Vie immobile (Tarabuste, 2013). C’est aussi à cette période que j’ai commencé à prendre des cours de chant au conservatoire Jean-Philippe Rameau du 6ème arrondissement dans la classe de Xavier le Maréchal ; j’y ai découvert ma tessiture de haute-contre. J’ai alors beaucoup travaillé, espérant rattraper ce qui m’avait manqué : des années de formation musicale. En peu de temps, à force de travail et grâce au concours de mes professeurs, j’ai acquis assez vite une technique vocale relativement solide, trop vite même, parce que je me suis retrouvé à faire des concerts au bout de cinq ou six ans alors que fondamentalement je n’y étais pas prêt. C’est aussi à ce moment là que j’ai découvert le luth à l’occasion d’un spectacle de nô de Zéami dans lequel je jouais le rôle de Semimaru, un jeune homme aveugle de naissance abandonné par son père et qui erre dans la montagne en compagnie de sa sœur Sakagami, une jeune fille très belle qui souffre d’épisodes de folie inexplicable. Touché par le répertoire baroque, j’ai persévéré dans l’apprentissage de l’instrument et j’ai préféré le plaisir solitaire de m’accompagner sur des pièces de John Dowland à l’exercice des concerts pour la Fondation Royaumont, le Musée de Cluny ou l’Abbaye Royale de Fontevraud, des concerts qui me paralysaient totalement.
Comme je lisais beaucoup, j’ai fait la connaissance d’écrivains à Paris et spécifiquement de Nicolas Genka qui m’a confié Narimasu, un texte initialement dédicacé au metteur en scène argentin Victor Garcia destiné au Festival d’automne à Paris. J’ai connu Nicolas Genka après la lecture de L’Épi monstre, un texte au lyrisme visionnaire publié en 1962 et qui annonce la révolution à venir. J’avais écrit à l’auteur, nous nous étions rencontrés et dès lors nous avons partagé de longs moments faits de bohême et d’errance intellectuelle. J’avais l’impression de revivre avec lui un peu de cette époque à laquelle j’aurais voulu vivre, entouré par quelques figures emblématiques : Nabokov, Mishima, Genet… J’ai composé des chansons à partir de certains de ses textes inédits et j’en ai fait un cérémonial singulier
La jeune Fille et la mort.
Le spectacle a vu le jour à l’Ego théâtre que dirigeait Bernard Damien au 59 rue de Rivoli avant de le reprendre à la Maison de la poésie – Théâtre Molière chez Michel de Maulne puis à la Comédie de Clermont-Ferrand, scène nationale.

La jeune Martyre, 1855, Paul Delaroche
L’idée de faire de la mise en scène date sans doute de cette époque là et je considère ce spectacle comme ma date de naissance artistique. Suite à ce premier spectacle, je n’aurai d’ailleurs de cesse de m’emparer de textes poétiques et de matériaux sonores, montant des spectacles qui réunissent des écrivains contemporains, des musiciens et des comédiens. C’est ainsi que j’ai créé le Stabat Mater Furiosa de Jean-Pierre Siméon, un spectacle autour des textes de Philippe Jaccottet, Dans la nuit la plus claire jamais rêvée ou encore récemment Je suis prête, un spectacle mêlant la tragédie humaniste d’Etienne Jodelle Didon se sacrifiant à des fragments dialogués de plasticiennes : Marina Abramovic, Annette Messager, Cindy Sherman, Sophie Calle…
Les choses se sont précisées lorsque j’ai été engagé comme artiste associé à
l’Atelier du Rhin – Centre Dramatique National à Colmar.
De 2005 à 2008, j’ai passé trois années d’intense activité sous la houlette de Matthew Jocelyn où j’ai dû me montrer polyvalent, à la fois comédien, assistant à la mise en scène, metteur en scène, professeur pour les élèves des classes théâtre, responsable du comité de lecture et coach pour les Jeunes Voix du Rhin, les jeunes chanteurs de l’opéra studio de l’Opéra National du Rhin. J’y ai réalisé moi-même des mises en scène et notamment Une Folle journée, un spectacle créé à partir des Noces de Figaro de Mozart et du Barbier de Séville de Rossini. Lorsque j’ai été licencié du Centre Dramatique suite au départ de son directeur, j’ai été convaincu qu’il fallait que je poursuive ma route dans l’opéra et uniquement dans l’opéra.

Ariane, 1898, John William Waterhouse
Pour continuer de me former à la mise en scène,
j’ai décidé d’assister des metteurs en scène forçant parfois quelques portes en France et à l’étranger. C’est ainsi que j’ai bâti jusqu’à aujourd’hui mon expérience à travers une cinquantaine de productions et que j’ai eu la chance de travailler dans les plus grands théâtres lyriques d’Europe, du Royal Opera House où j’ai eu ma première expérience comme observer jusqu’à l’Opéra National de Paris où je suis maintenant titulaire d’un poste d’assistant à la mise en scène, en passant à l’étranger par le De Nederlandse Opera à Amsterdam, la Staatsoper unter den Linden à Berlin, la Staatsoper de Stuttgart, le Teatro alla Scala de Milan, la Philharmonie du Luxembourg, la Komische Oper Berlin, le Teatro Real de Madrid, le Teatro del Maggio Musicale Fiorentino de Florence et en France à Limoges, Dijon, Lille, Caen… J’y ai assisté de nombreux metteurs en scène parmi lesquels Jossi Wieler et Sergio Morabito, Ivo van Hove, Barrie Kosky, Claus Guth, Calixto Bieito, Stefan Herheim, Romeo Castellucci… et j’ai eu la chance de côtoyer les plus grands chefs d’orchestre : Esa Pekka-Salonen, Simon Rattle, Hartmut Haenchen, Philippe Jordan, Fabio Luisi, Vladimir Jurowski…
Parallèlement à ces expériences qui étaient mon gagne-pain, et grâce au système de l’intermittence qui m’a permis de continuer de travailler pour moi, je me suis entraîné à faire des mises en scène. Certaines, pour mon simple plaisir ; c’est-à-dire que concrètement je choisissais une œuvre, je passais de longues heures en bibliothèque, un casque sur les oreilles et une pile de livres à lire et je m’interrogeais sur ce que je pouvais faire de l’œuvre. Pour certaines œuvres qui me plaisaient beaucoup comme Lulu de Berg, Pelléas et Mélisande de Debussy, j’ai développé tout un projet et le scénario détaillé d’une mise en scène. J’ai également répondu à des concours comme celui organisé par le CFPL (Centre Français de Promotion Lyrique) pour la réalisation des Caprices de Marianne de Henri Sauguet d’après l’œuvre d’Alfred de Musset, concours qui m’a amené en finale, puis j’ai répondu à l’appel à candidatures pour la mise en scène de Mitridate de Mozart au Théâtre Royal de la Monnaie de Bruxelles. Après ces travaux pratiques, Laurent Joyeux, le directeur de l’Opéra de Dijon m’a proposé de mettre en scène
L’Orfeo de Monteverdi.

La façon dont je vais à la rencontre d’une œuvre est à la fois émotive et rationnelle.
C’est sans doute pour cela que je suis plus à l’aise avec l’opéra qu’avec le théâtre. La musique fait appel à d’autres fonctions cognitives et j’ai besoin de celles-là pour m’ouvrir des passages qui me permettent ensuite de composer ma mise en scène. À l’écoute d’une œuvre, il y a souvent un moment qui va me toucher plus que tous les autres et c’est à ce moment particulier que je vais revenir de manière obsessionnelle pour essayer de comprendre pourquoi ce moment m’interpelle plus que les autres. C’est dans la compréhension de mon émotion qui nécessite un travail d’introspection approfondie de l’œuvre que se cache pour moi la clef de l’œuvre toute entière et la clef de voûte de ma mise en scène. Ce moment particulier est souvent celui dans lequel le lyrisme s’exprime dans sa plus profonde vérité. J’aime beaucoup la définition qu’en donne Annie le Brun. Pour elle, le lyrisme est “lié à la plus violente conscience de la disparition. C’est d’abord une façon de voir la beauté en transparence sur ce qui la menace.”
Toute ma vie est liée à l’expérience poétique :
“Pour aimer l’opéra, il faut être familier du royaume des esprits” comme l’écrit Jean Starobinski dans Les Enchanteresses. En essayant d’échapper à la monotonie, au spleen, aux contingences par l’ivresse, les promenades solitaires et le sentiment amoureux, j’ai traversé les années avec indolence en compagnie de poètes, de cinéastes, de peintres et de compositeurs. Ils m’ont appris la clarté, la finesse et la précision du trait. Ils m’ont appris la profondeur et le grain de la matière, de la couleur, du timbre. Ils m’ont appris le style et l’élégance du style, c’est-à-dire l’art de la proportion et celui d’assembler avec rythme et harmonie.
Mon travail s’apparente en effet beaucoup à celui d’un écrivain, d’un réalisateur, mais aussi à celui du chef d’orchestre. Je ne me sens pas au service, selon l’expression consacrée, d’une œuvre ou d’un auteur ; en tout cas, pas seulement. Ce qui m’intéresse, c’est ce qui fait défaut dans l’œuvre. L’œuvre est toujours contestable ; hier comme aujourd’hui : “Les chefs d’œuvre nous enjoignent l’irrespect, voire le saccage” disait Pierre Boulez et ailleurs il ajoutait que “L’important – non, l’essentiel ! au théâtre comme avec tout autre moyen d’expression, c’est la greffe.” C’est ainsi qu’on respecte les œuvres, me semble-t-il, en commençant par les déconstruire, les démanteler, retirer chez elles tout ce qui fait fiction pour en saisir l’essence et s’autoriser ensuite, seulement ensuite, la reconstruction d’une dramaturgie parallèle. Aujourd’hui, le nombre d’œuvres qui m’inspirent ne cesse de s’allonger et mes goûts évoluent mais pour n’en citer que quelques-unes, je rêve de monter aussi bien des œuvres comme L’Incoronazione di Poppea de Monteverdi que L’Écume des jours de Denisov, aussi bien Alcina de Haendel qu’Eugène Onéguine de Tchaïkovski, Die Bassariden de Henze, Die Teufel von Loudun de Penderecki et la liste est longue…
Si mon hyper-sensibilité m’a quelquefois isolé, elle m’a aussi permis de sonder la nature humaine et le cosmos avec singularité. La juvénilité qui se lit dans mon corps et sur les traits de mon visage vient sans doute de ce que je n’ai pas quitté ce moment de mon adolescence où l’exaltation était mêlée à un inconfort, une mélancolie permanente et où j’ai tenté alors de donner une forme alchimique à ce double sentiment. Ce qui m’intéresse en définitive, c’est de sonder la nature humaine : les relations, les passions, la nature nouvelle de nos émotions. Les décrypter, en montrer le tragique et la beauté avec le plus de tendresse possible.